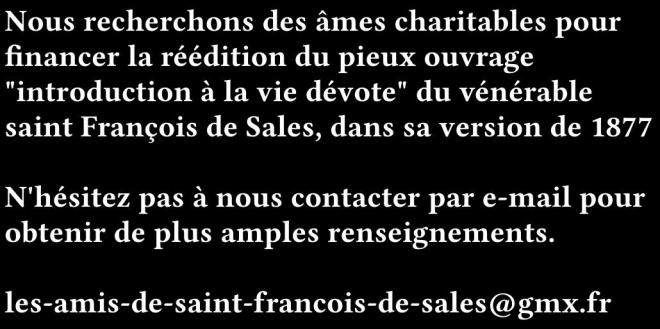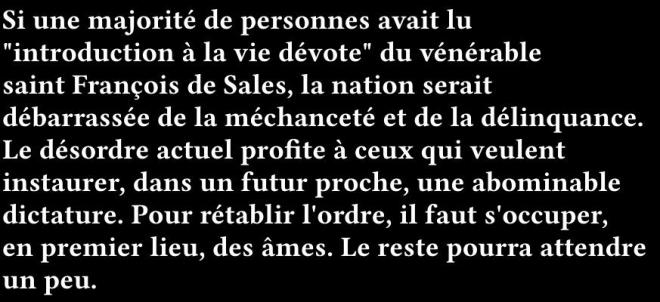« De la nature des tentations, et de la différence qu’il y a entre les sentir et y consentir » (Chapitre III, quatrième partie)
Imaginez-vous, Philothée, une jeune princesse fort aimée de son époux, et dont quelque jeune libertin cherche à corrompre la fidélité par un infâme confident. D’abord ce confident expose à la princesse l’intention de son maître ; elle agrée ou rejette sa proposition, et enfin elle y consent ou la repousse. C’est ainsi que Satan, le monde et la chair, voyant une âme attachée au Fils de Dieu comme son épouse, lui offrent des tentations dans lesquelles le péché lui est proposé ; d’abord il lui plaît ou lui déplaît, et enfin elle y consent ou le rejette. Voilà les degrés qui conduisent à l’iniquité : la tentation, la délectation et le consentement ; et, bien que ces trois choses ne se distinguent pas aussi évidemment en toutes sortes de péchés, on les connaît pourtant d’une manière sensible dans les grands péchés.
Quand une tentation durerait toute notre vie, elle ne peut nous rendre désagréables à la divine Majesté, pourvu qu’elle ne nous plaise pas et que nous n’y consentions pas, parce que dans la tentation nous n’agissons pas, mais nous souffrons ; puisque nous n’y prenons point de plaisir, elle ne peut en aucune manière nous rendre coupables. Saint Paul souffrit longtemps des tentations de la chair, et, loin qu’elles le rendissent désagréable à Dieu, au contraire Dieu en était glorifié. La bienheureuse Angèle de Foligny en fut aussi si cruellement tourmentée, que leur récit excite la pitié. Celles de saint François et de saint Benoît ne furent pas moins pénibles, lorsqu’un se jeta dans les épines, et l’autre dans la neige, pour les combattre ; et cependant, loin de leur faire rien perdre de la grâce de Dieu, elles l’augmentèrent beaucoup en eux.
Il faut donc avoir un grand courage dans les tentations, Philothée, et ne se croire jamais vaincu tandis qu’elles déplaisent, observant bien la différence qu’il y a entre les sentir et y consentir : car on peut les sentir, quoiqu’elles déplaisent ; mais on ne peut y consentir sans qu’elles plaisent, puisque le plaisir est ordinairement un degré de consentement. Que les ennemis de notre salut présentent donc autant d’amorces et d’appâts qu’ils pourront ; qu’ils se tiennent toujours à la porte de notre cœur pour y entrer ; qu’ils nous fassent autant de propositions qu’ils voudront : tant que nous serons dans la disposition de ne pas nous y plaire, il est impossible que nous offensons Dieu ; non plus que l’époux de la princesse dont je vous ai parlé ne peut lui savoir mauvais gré de la proposition qu’on lui aurait faite, si elle n’y avait nullement consenti. Il y a néanmoins cette différence entre elle et l’âme, que la princesse peut chasser cet infâme envoyé et ne plus l’entendre, tandis qu’il n’est pas toujours au pouvoir de l’âme de ne point sentir la tentation, bien qu’elle puisse toujours n’y pas consentir. C’est pourquoi la tentation, bien qu’elle dure longtemps, ne peut nous nuire tant qu’elle nous déplaît.
À l’égard de la délectation qui peut suivre la tentation, il est à remarquer que nous avons comme deux parties dans notre âme, l’une inférieure, et l’autre supérieure ; que l’inférieure ne suit pas toujours la supérieure ; et agit même séparément : il arrive souvent de là que la partie inférieure se plaît à la tentation, sans le consentement de la partie supérieure, et même contre son gré. C’est justement le combat que saint Paul décrit, quand il dit que la chair lutte contre l’esprit, et qu’il y a en lui une loi des membres et une loi de l’esprit, et autres choses semblables.
Avez-vous jamais vu, Philothée, un grand brasier couvert de cendres ? Quand on vient, dix à douze heures après, y chercher du feu, on a de la peine à en trouver : il y est néanmoins, et ce qui reste peut servir à ranimer tous les autres charbons éteints. Voilà comme la charité, qui est notre vie spirituelle, subsiste en nous malgré les plus grandes tentations ; car la tentation, jetant sa délectation dans la partie inférieure de l’âme, charge et couvre, pour ainsi dire, cette pauvre âme de tant de fâcheuses dispositions, qu’elles y réduisent l’amour de Dieu à bien peu de choses : il ne paraît nulle part, sinon au fond du cœur ; encore semble-t-il qu’il n’y soit pas, et on a bien de la peine à l’y trouver. Il y est néanmoins très réellement, puisque, malgré le trouble qui règne dans l’âme et dans le corps, on a toujours la résolution de ne consentir ni au péché ni à la tentation ; que la délectation qui plaît à l’homme extérieur déplaît à l’homme intérieur, et que, bien qu’elle soit, pour ainsi parler, tout autour de la volonté, elle n’est pas en elle. Or c’est ce qui doit faire juger que cette délectation est involontaire, et que dès lors elle ne peut être un péché.
« Il faut s’armer de courage » (Chapitre II, quatrième partie)
Quelque belle et douce que soit la lumière, elle nous éblouit quand nous avons été longtemps dans l’obscurité ; quelque doux et honnêtes que soient les habitants d’un pays où l’on est étranger, on y est d’abord embarrassé. Il pourra donc se faire, Philothée, que ce grand divorce avec les folles vanités du monde et ce changement de vie donnent à votre cœur de la tristesse et de l’abattement. Mais ayez un peu de patience, je vous en prie, tout cela ne sera rien avec le temps, et n’est d’abord que l’étonnement causé par la nouveauté : attendez, les consolations viendront bientôt. Vous regretterez peut-être l’approbation que les personnes légères donnaient à vos vanités ; mais, ô Dieu ! Voudriez-vous perdre la gloire dont le Dieu de vérité vous couronnera éternellement ? Les faux plaisirs des années passées viendront encore flatter votre cœur pour l’engager de nouveau dans leurs liens ; mais voudriez-vous renoncer aux délices de l’éternité pour des joies si trompeuses ? Croyez-moi, si vous persévérez, vous verrez bientôt votre persévérance récompensée par des consolations délicieuses, et vous avouerez que le monde n’a que du fiel en comparaison de ce miel céleste, et qu’un seul jour de dévotion vaut mieux que mille années de la vie mondaine.
Mais vous considérerez la hauteur de la montagne où se trouve la perfection chrétienne, et vous dites : comment pourrai-je y monter ? Courage, Philothée ! Les petites abeilles n’ont pas encore d’ailes pour aller cueillir le miel sur les fleurs des montagnes et des collines ; mais se nourrissent peu à peu du miel que leurs mères leur ont préparé, leurs ailes croissent, et elles se fortifient si bien, qu’enfin elles prennent l’essor et volent jusqu’aux lieux les plus élevés. Nous devons nous considérer comme de petits moucherons dans les voies de la dévotion ; nous ne pouvons pas, comme nous le voudrions, avoir tout à coup la perfection ; mais commençons toujours à nous y former par nos désirs et par nos bonnes résolutions ; espérons qu’un jour nous aurons assez de force pour y parvenir ; vivons, en attendant, de l’esprit si doux de tant d’instructions que les saints et les saintes nous ont laissées, et prions Dieu, comme le prophète royal, de nous donner des ailes de la colombe, afin que nous puissions non seulement nous élever à la perfection de la vie présente, mais encore jusqu’au repos de la bienheureuse éternité.
« Il ne faut pas s’arrêter aux discours des enfants du siècle » (Chapitre I, quatrième partie)
Aussitôt que le monde s’apercevra de votre dévotion, la satire et la médisance ne manqueront pas de vous affliger. Les libertins feront passer votre changement pour un artifice hypocrite, et diront que vous recourez à Dieu parce que le monde vous a froissé. Vos amis s’empresseront de vous faire des remontrances qu’ils croiront charitables et prudentes, sur la tristesse de la dévotion, sur la perte de votre crédit dans le monde, sur la conservation de votre santé, sur l’incommodité que vous causerez aux autres, sur les affaires qui pourraient en souffrir, sur la nécessité de vivre dans le monde comme l’on y vit, et sur tous les moyens qu’on a de faire son salut sans tant de mystères.
Tout cela n’est qu’un sot et vain babil du siècle ; au fond, ces gens-là n’ont aucun soin véritable de vos affaires et de votre santé. Si vous étiez du monde, dit le Sauveur, le monde aimerait ce qui lui appartient ; mais parce que vous n’êtes pas du monde, il vous hait. On voit des hommes et des femmes passer les nuits entières au jeu : y a-t-il une attention plus fatigante et plus chagrine que celle-là ? Cependant leurs amis ne leur en disent rien ; et parce que vous vous levez un peu plus matin qu’à l’ordinaire afin de vous préparer à la communion, chacun court au médecin et vous demande de vous guérir de l’humeur hypocondriaque et de la jaunisse. On passera trente nuits à danser, personne ne s’en plaint ; et, pour la seule nuit de Noël, chacun tousse et se plaint de la tête le jour suivant. Qui ne voit que le monde est un juge inique, complaisant pour ses enfants, mais dur et sévère pour les enfants de Dieu ?
Nous ne saurions être bien avec le monde qu’en nous perdant avec lui ; il n’est pas possible de le satisfaire, tant il est bizarre. Jean est venu, dit le Sauveur, ne mangeant ni ne buvant, et vous dites qu’il est possédé du diable. Le Fils de l’homme est venu en mangeant et en buvant, et vous dites qu’il est un Samaritain. Il est vrai, Philothée, si, par condescendance pour le monde, vous vous laissez aller à jouer et à danser, il s’en scandalisera. Si vous ne le faites pas, il vous accusera d’hypocrisie ou de mélancolie. Si vous vous parez, il l’interprétera mal. Si vous vous négligez, ce sera pour lui bassesses de cœur. Il appellera votre gaieté dissolution, votre mortification humeur sombre ; et, comme il vous regarde toujours de mauvais œil, jamais vous ne pourrez lui plaire. Il fait passer nos imperfections pour des péchés, nos péchés véniels pour des péchés mortels, et nos péchés d’infirmité pour des péchés de malice. Tandis que la charité est bénigne, comme dit saint Paul, le monde est malin ; tandis que la charité ne pense mal de personne, le monde pense toujours mal ; quand il ne peut condamner nos actions, il accuse nos intentions. Enfin, soit que les moutons aient des cornes, soit qu’ils n’en aient pas, qu’ils soient blancs ou qu’ils soient noirs, le loup ne laissera pas de les manger s’il peut. Ainsi, quoi que nous fassions, le monde nous fera toujours la guerre. Si nous sommes longtemps aux pieds d’un confesseur, il demandera ce que nous pouvons lui dire ; si nous y sommes peu de temps, il prétendra que nous ne lui disons pas tout. Il étudiera nos mouvements ; et, pour une parole un peu vive, il protestera sur nous sommes insupportables. Il prendra pour avarice le soin de nos affaires, et il appellera notre douceur niaiserie. Mais quand il s’agit des enfants du siècle, la colère est généreuse, l’avarice sage économie, et les manières trop libres une honnête conversation.
Laissons ce monde aveugle, Philothée ; qu’il crie tant qu’il voudra, comme un chat-huant pour inquiéter les oiseaux du jour. Soyons fermes dans nos desseins, invariables dans nos résolutions, et la persévérance fera voir si le parti de la dévotion que nous avons pris est sérieux et sincère. Les comètes et les planètes paraissent presque également lumineuses ; mais les comètes disparaissent en peu de temps, au lieu que la lumière des planètes est perpétuelle. De même l’hypocrisie et la vraie vertu se ressemblent fort, et on les reconnaît à ce que celle-là n’a point de consistance et se dissipe comme la fumée, au lieu que celle-ci est ferme et constante. Au reste, il est bon, dans les commencements de notre dévotion, d’être méprisés et de recevoir quelques injustes reproches ; car on se fortifie ainsi contre la vanité et contre l’orgueil, qui détruisent quelquefois les premiers fruits de la piété : malheur figuré par le commandement de Pharaon fit aux sages-femmes d’Égypte de tuer les enfants mâles d’Israël le jour même de leur naissance. Enfin nous sommes crucifiés au monde, et le monde doit nous être crucifié. Il nous prend pour des fous : regardons-le comme un insensé.
« Des jeux défendus » (Chapitre XXXII, troisième partie)
Les jeux de dés, de cartes et autres semblables, où le gain dépend principalement du hasard, ne sont pas seulement des divertissements dangereux, comme les danses, mais ils sont absolument et de leur nature mauvais et blâmables ; c’est pourquoi ils sont défendus par les lois civiles et ecclésiastiques. Mais quel grand mal y a-t-il ? Direz-vous. Je réponds que le gain n’est pas réglé par la raison, mais par le hasard, qui favorise souvent celui qui ne le mérite pas. Mais, répliquez-vous, nous en sommes aussi convenus. Je réponds que dès lors celui qui gagne ne fait point tort aux autres. Cependant, il ne s’ensuit pas que la convention soit raisonnable et le jeu aussi, parce que le gain, qui doit être le prix de l’habileté, devient celui du hasard, lequel ne dépend nullement de nous et ne mérite rien.
De plus, le jeu n’est fait que pour nous divertir ; et néanmoins ces jeux de hasard ne sont point de véritables divertissements, mais des occupations violentes. Car n’est-ce pas une violente occupation que d’avoir toujours l’esprit tendu par une application forcée, et agité par des inquiétudes et des vivacités continuelles ? Y a-t-il une attention plus triste, plus sombre et plus chagrine que celle des joueurs, qui se dépitent et s’emportent si l’on dit un mot, si l’on rit, si l’on tousse auprès d’eux ?
Enfin ces jeux ne réjouissent que ceux qui gagnent ; et cette joie n’est-elle pas coupable, puisqu’elle suppose la perte et le déplaisir du prochain ? En vérité, un tel plaisir est indigne, et voilà les trois raisons pour lesquelles l’on a défendu ces jeux. Saint Louis, étant sur mer, et sachant que le duc d’Anjou, son frère, jouait avec messire Gauthier de Nemours, se leva, quoique malade, alla en chancelant dans leur chambre, prit les tables, les dés et une partie de l’argent, et jeta tout dans la mer, en leur témoignant une vive indignation. La vertueuse et jeune Sara parlant à Dieu de son innocence, dans la belle prière qu’elle lui fit : « Vous le savez, Seigneur, dit-elle, je ne me suis jamais trouvé dans la société des joueurs. »
« Des divertissements, et premièrement de ceux qui sont honnêtes et permis » (Chapitre XXXI, troisième partie)
La nécessité d’un divertissement honnête pour donner quelque relâche à l’esprit et pour soulager le corps, est universellement reconnue. Le bienheureux Cassien rapporte qu’un chasseur, ayant trouvé saint Jean l’Évangéliste qui jouait avec une perdrix qu’il tenait sur son doigt, lui demanda pourquoi un homme de son caractère perdait le temps à cet amusement ; et le saint lui ayant demandé pourquoi il ne tenait pas son arc toujours bandé, le chasseur lui répondit que s’il l’était toujours il perdrait sa force. Sur cela ce saint Apôtre répliqua : « ne vous étonnez donc pas que je donne quelque relâche à mon esprit, car ce n’est que pour le rendre plus propre à la contemplation. » N’en doutons pas, c’est un vice que cette sévérité d’un esprit sauvage qui ne veut pour soi aucun divertissement, et qui n’en permet aucun à personne.
Prendre l’air en se promenant, s’égayer dans une douce et agréable conversation, jouer d’un instrument, chanter, aller à la chasse, sont des divertissements si honnêtes, que, pour en bien user, il n’est besoin que de la prudence commune, qui règle toutes choses selon l’ordre, selon le lieu, selon toute la mesure convenable.
Le jeu où le gain est comme le prix ou la récompense de l’habileté du corps ou de l’esprit, comme les jeux de paume, du ballon, du mail, les courses de bagues, les échecs et les dames, sont des divertissements bons et permis ; il faut seulement éviter l’excès, soit quant au temps qu’on y donne, soit quant au prix qu’on y joue. Si on donne trop de temps au jeu, ce n’est plus un divertissement, mais une occupation ; bien loin dès lors de soulager l’esprit et le corps, il échauffe l’esprit et le fatigue, comme il arrive à ceux qui, ayant joué cinq à six heures aux échecs, ont la tête brisée, ou qui, ayant joué longtemps à la paume, quittent le jeu accablés de fatigue. Si le prix du jet, c’est-à-dire ce que l’on joue, est trop élevé, les inclinations honnêtes des joueurs se dérèglent, et deviennent des passions ; et d’ailleurs il est injuste de proposer un tel gain pour le prix de ces industries, qui sont, au fond, peu importantes et utiles.
Surtout prenez garde, Philothée, à ne point vous passionner pour tout cela ; car, quelques honnêtes que soit un divertissement, c’est un vice que d’y attacher son affection. Je ne dis pas qu’il ne faille pas prendre plaisir au jeu quand on y joue, car autrement on ne se divertirait point ; mais je dis qu’il ne faut pas y mettre trop de désir, d’empressement et d’ardeur.
« Quelques autres avis touchant les discours » (saint Louis, saint David) (Chapitre XXX, troisième partie)
Que votre langage soit sincère, doux, naturel et fidèle. Gardez-vous des duplicités, des artifices et des dissimulations : car, bien qu’il ne soit pas bon de dire toujours la ce qui est vrai, cependant il n’est jamais permis de blesser la vérité. Accoutumez-vous à ne jamais mentir, ni de propos délibéré, ni par excuse, ni autrement, vous souvenant que Dieu est le Dieu de vérité. Si donc quelque mensonge vous échappe par mégarde, et que vous puissiez réparer votre faute sur-le-champ par quelque explication ou d’une autre manière, n’y manquez pas. Une excuse véritable a bien plus de grâce et de force pour justifier qu’un mensonge étudié.
Bien que l’on puisse quelquefois discrètement et prudemment déguiser et couvrir la vérité par quelque artifice de paroles, on ne peut pourtant pratiquer cela que dans les choses importantes, quand la gloire et le service de Dieu le demandent évidemment ; hors de là les artifices sont dangereux, car, comme le dit l’Écriture sacrée, « le Saint-Esprit n’habite point dans un cœur dissimulé et double. » Il n’y eut jamais de finesse meilleure et plus souhaitable que la simplicité. La prudence mondaine avec tous ses artifices est le caractère des enfants du siècle ; mais les enfants de Dieu marchent sans détours et ont le cœur sans replis. « Qui marche simplement, dit le Sage, marche avec confiance. » Le mensonge, la duplicité, la dissimulation, annoncent toujours un esprit bas et faible.
Saint Augustin avait dit, au quatrième livre de ses Confessions, que son âme et celle de son ami n’étaient qu’une seule âme ; que la vie lui était en horreur depuis la mort de son ami, parce qu’il ne voulait pas vivre à moitié, et que pour cela même il craignait cependant de mourir, de peur que son ami ne mourût tout entier. Ces paroles lui semblèrent ensuite trop affectées et artificieuses, et il les blâma dans le livre de ses Rétractations, où il les appelle une grande ineptie. Voyez-vous, Philothée, la délicatesse de cette sainte et belle âme sur l’affectation des paroles ? C’est un grand ornement de la vie chrétienne que la fidélité, la sincérité et la naïveté du langage. « Je l’ai dit, et je le ferai, protestait le saint roi David ; j’observerai mes voies, de peur que ma langue ne me rende coupable de quelque péché. Ah ! Seigneur, mettez une garde à ma bouche ; et, pour que rien de blâmable n’en sorte, attachez la circonspection à mes lèvres. »
C’est un avis du roi saint Louis, de ne contredire personne, sinon en cas de péché ou de quelque dommage, afin d’éviter toutes les contestations. Mais quand il est nécessaire de contredire les autres et d’opposer son opinion à la leur, ce doit être avec tant de douceur et de ménagement, que l’on ne paraisse pas vouloir faire violence à leur esprit : aussi bien ne gagne-t-on rien en prenant les choses avec chaleur.
La règle de parler peu, si recommandée par les anciens sages, ne se prend pas en ce sens que l’on dise peu de paroles, mais qu’on n’en dise pas beaucoup d’inutiles. Car en ce point on n’a pas égard à la quantité, mais à la qualité ; et il faut, ce me semble, éviter deux extrémités. La première est de prendre un air fier et austère par un silence affecté dans les conversations, parce que ces manières marquent de la défiance ou du mépris. La seconde est de se laisser aller à un flux de paroles qui ne laisse à personne le temps de parler, parce que c’est le caractère d’un esprit éventé et léger.
Saint Louis ne trouvait pas bon qu’on parlait en secret, et en conseil, comme on disait de son temps, particulièrement à table, de peur de faire penser aux autres que l’on parle mal d’eux. « Si, étant à table, en bonne compagnie, disait-il, on a quelque chose de bon et de réjouissant à dire, on doit le dire tout haut ; s’il s’agit d’une affaire sérieuse et importante, on n’en doit parler à personne. »
Comment rétablir l’ordre ?
« De la médisance » (Chapitre XXIX, troisième partie)
L’inquiétude, le mépris du prochain et l’orgueil sont inséparables du jugement téméraire, qui produit encore beaucoup d’autres effets pernicieux, parmi lesquels la médisance, qui est la peste des conversations, tient le premier rang. Oh ! Que n’ai-je un des charbons du saint autel pour purifier les lèvres des hommes de toute leur iniquité, comme le Séraphin purifia celles du prophète Isaïe, pour le rendre digne de bien parler de Dieu ! Certainement, si l’on pouvait bannir du monde la médisance, on y exterminerait une grande partie des péchés.
Si quelqu’un enlève au prochain sa bonne réputation, outre le péché qu’il commet, il est obligé de lui en faire une réparation entière et proportionnée à la nature, à la qualité et aux circonstances de la médisance ; car nul ne peut entrer dans le ciel avec le bien d’autrui, et l’honneur est le plus grand et le plus cher de tous les biens extérieurs. Nous avons trois vies différentes : la vie spirituelle, dont la grâce de Dieu est l’origine ; la vie corporelle, dont notre âme est le principe ; et la vie civile, dont la bonne réputation est le fondement. Le péché nous fait perdre la première, la mort nous ravit la seconde, et la médisance nous ôte la troisième. La médisance est une espèce de meurtre, et le médisant se rend coupable, par un seul coup de langue, d’un triple homicide spirituel : le premier et le second à l’égard de son âme et celle de la personne à qui il parle, et le troisième à l’égard de la personne dont il détruit la réputation. C’est de là que saint Bernard dit que celui qui a fait la médisance et celui qui l’écoute ont le diable sur eux, mais l’un dans sa langue, et l’autre dans son oreille ; et David, parlant des médisants, dit que « ils ont affilé leur langue comme le serpent, » c’est-à-dire que, comme la langue du serpent a deux pointes, selon la remarque d’Aristote, celle du médisant blesse d’un seul coup la réputation de celui dont il parle et l’oreille de celui qui l’écoute. Je vous conjure donc, Philotée, de ne médire jamais, directement ni indirectement ; gardez-vous bien de charger le prochain de faux crimes, ni de découvrir ceux qui sont secrets, ni d’augmenter ceux qui sont connus, de mal interpréter les bonnes œuvres, ni de nier le bien que vous savez être en quelqu’un, ni de dissimuler malicieusement, ni de le diminuer ; car en tout cela vous offenseriez beaucoup Dieu, surtout si c’était par une fausse accusation, car alors il y aurait un double péché : mentir, et nuire au prochain.
Ceux qui préparent la médisance par des protestations honorables pour ceux dont ils vont parier sont les plus dangereux. Je proteste, dit-on, que j’aime monsieur un tel, et qu’au reste c’est un galant homme ; il faut pourtant avouer qu’il eut tort de commettre une telle perfidie. C’est une fort vertueuse fille, mais enfin elle fut surprise. Ne voyez-vous pas l’artifice ? Celui qui veut tirer de l’arc attire tant qu’il peut la flèche à soi, mais ce n’est que pour la décocher avec plus de force. Il semble aussi que ces médisants retirent leur médisance avec eux, mais ce n’est que pour la lancer avec plus de malice et pour la faire pénétrer plus avant dans les cœurs.
La médisance dite en forme de plaisanterie est la plus cruelle de toutes ; on peut en comparer la malignité à celle de la ciguë, qui, n’étant qu’un poison lent, et contre lequel on a beaucoup de préservatifs, devient irrémédiable si elle est mêlée avec le vin. Car c’est ainsi qu’une médisance qui ne ferait qu’entrer par une oreille et sortir par l’autre, fait une violente impression sur l’esprit quand on sait lui donner un tour subtil et plaisant. C’est ce que David veut nous faire entendre par ces paroles : « Ils ont le venin de l’aspic sur les lèvres. » En effet, la piqûre de l’aspic est presque imperceptible ; elle excite seulement une démangeaison agréable, qui dilate le cœur et les entrailles, et y fait glisser le venin si intimement, que l’on ne peut plus y porter remède.
Ne dites pas : Un tel est un ivrogne ou un voleur, pour l’avoir vu une fois s’enivrer ou faire un larcin ; ce serait une imposture, puisqu’un seul acte ne constitue pas une habitude. Le soleil s’arrêta une fois en faveur de la victoire de Josué ; une autre fois il s’obscurcit en faveur de celle du Sauveur mourant sur la croix : nul ne dira pour cela qu’il soit immobile et obscur. Noé et Loth s’enivrèrent une fois : ils ne furent pourtant des ivrognes ni l’un ni l’autre ; saint Pierre ne fut pas un blasphémateur, un sanguinaire, pour avoir blessé un homme et blasphémé dans une occasion. Le nom de vicieux ou de vertueux suppose l’habitude d’un vice ou d’une vertu. Bien qu’un homme ait été vicieux depuis longtemps, on court le risque de mentir quand on le nomme vicieux : c’est ce qui arriva à Simon le lépreux, qui appelait Madeleine une pécheresse : car alors elle était une très-sainte pénitente, et Notre-Seigneur la défendit contre ses reproches. Le pharisien qui regardait le publicain comme un très grand pécheur se trompait encore grossièrement, puisque le publicain avait été justifié à l’heure même. Hélas ! Puisque la bonté de Dieu est si grande qu’un seul moment suffit pour obtenir et pour recevoir sa grâce, quelle assurance pouvons-nous avoir qu’un homme qui était hier pécheur le soit aujourd’hui ? Le jour précédent ne doit pas juger le jour présent ; il n’y a que le dernier jour qui juge tous les autres.
Nous ne pouvons donc jamais dire qu’un homme soit méchant sans danger de mentir ; tout ce que nous pouvons dire, s’il faut en parler, c’est qu’il fit une telle action mauvaise, que sa vie fut coupable en tel temps ; actuellement il fait le mal ; mais on ne peut tirer nulle conséquence d’hier à aujourd’hui ni d’aujourd’hui au jour d’hier, et moins encore du jour présent au lendemain. Il faut accorder cette délicatesse de conscience avec la prudence nécessaire pour se garantir d’un autre danger auquel succombent ceux qui, pour éviter la médisance, donnent des louanges au vice. Si donc une personne est sujette à médire, ne dites pas, en l’excusant, qu’elle est libre, franche et sincère. Si une autre paraît manifestement vaine, n’allez pas dire qu’elle a le cœur noble et généreux. N’appelez pas les privautés dangereuses des simplicités et des naïvetés d’une âme innocente. Ne donnez pas à la désobéissance le nom de zèle, ni à l’arrogance celui de générosité, ni à la volupté celui d’amitié. Non, Philothée, il ne faut pas, en fuyant la médisance, flatter les autres vices, ni les entretenir ; mais on doit dire rondement et franchement qu’un vice est un vice, et blâmer ce qui blâmable ; ce sera indubitablement glorifier Dieu, pourvu qu’on observe les conditions suivantes.
Premièrement, on ne doit blâmer les vices du prochain que pour l’utilité de celui de qui on parle, ou de ceux à qui on parle. On parle devant de jeunes personnes des familiarités indiscrètes et dangereuses de telles et telles, de la liberté d’un tel ou d’une telle en paroles ou en beaucoup de matières contraires à la pureté. Eh bien, si je ne blâme pas avec force cette conduite, et si je cherche à l’excuser, ces âmes tendres qui écoutent pourront s’en permettre autant. Il est donc utile que je blâme sur-le-champ ce que l’on en dit, à moins que je ne remette ce bon office à un temps plus convenable et à une occasion où la réputation de ces personnes en souffrira moins.
Il faut, en second lieu, que je sois obligé de parler, comme si je suis des premiers de la compagnie, et si mon silence peut passer pour une approbation ; si je suis des moins considérables, je ne dois rien censurer, mais je dois avoir une grande prudence dans mes paroles, pour ne dire que ce qu’il faut. Par exemple, il s’agit de quelque familiarité entre deux jeunes personnes, ô Dieu ! Philothée, comme je dois tenir la balance juste, et n’y rien mettre qui diminue ou exagère le fait ! Si donc il n’y a dans ce qu’on dit qu’une faible apparence ou une simple imprudence, je ne dirai rien de plus ; et s’il n’y a ni imprudence, ni apparence, et que l’on n’y voie rien, sinon un prétexte à la médisance, ou je ne dirai rien, ou je dirai cela même. La sainte Écriture compare souvent la langue à un rasoir, et avec raison ; car je dois être sur mes gardes quand je juge mon prochain, comme l’est un habile chirurgien qui fait une incision entre les nerfs et les tendons.
Enfin, quand on blâme les vices, il faut épargner la personne la plus qu’on peut. Il est vrai qu’on peut parler librement des pécheurs reconnus publiquement pour tels et diffamés ; mais ce doit être avec un esprit de charité et de compassion, et non pas avec arrogance ou présomption, ni en témoignant de la joie ; car ce dernier sentiment n’est que le propre d’un cœur bas et lâche. J’excepte de cette règle les ennemis déclarés de Dieu et de son Église, puisqu’il faut les décrier autant qu’on peut, comme les chefs des hérétiques et des schismatiques. C’est une charité que de crier au loup quand il est parmi les brebis, quelque part qu’il soit.
Chacun se permet de juger et de censurer les princes, et de médire des nations entières, selon les diverses opinions que l’on a à leur égard ; ne faites pas cette faute, parce que, outre l’offense de Dieu, elle pourrait susciter mille sortes de querelles.
Quand vous entendez mal parler du prochain, tâchez de rendre douteux ce que l’on en dit ; si vous ne pouvez le faire justement, du moins excusez son intention. Si cela ne se peut encore, témoignez qu’il vous fait compassion. Écartez le discours, pensant et faisant penser à la compagnie que ceux qui ne commettent pas de faute en sont uniquement redevables à la grâce de Dieu. Rappelez le médisant à lui-même par quelque douce manière, et dites librement ce que vous connaissez de bon dans la personne que l’on offense.
La France se meurt
La France est en train de couler par la faute de certains. Ces mêmes qui chantent à tue-tête que l’ennemi de la nation est le catholicisme. Mais, tout d’abord, qu’entendons-nous par « catholicisme » ? Est-ce un humanisme ? Est-ce un parti politique ? En réalité, la religion catholique ne correspond à rien de tout cela. Une définition négative de cette religion a été insufflée dans les esprits afin d’en détourner, volontairement, les âmes. Ainsi, en déracinant les esprits, la France se meurt à petit feu, de manière pratiquement imperceptible pour ceux qui sont habitués à une routine oisive, frivole et sans tonus.
Ceux qui s’acharnent à détruire notre belle nation annoncent publiquement, encore et toujours, que le seul ennemi à combattre est la religion catholique. La religion catholique, antérieure au XXIe siècle, est issue du Christianisme originel. Par conséquent, elle a pour vocation de sauver les âmes en les tirant du péché dans lequel celles-ci se complaisent, bien souvent, aveuglément.
Les ennemis de l’intérieur, ceux-là même qui utilisent, comme carburant, l’injustice, et, comme moteur, les institutions politiques, méprisent avec une rare véhémence la religion catholique de peur que ses enseignements refassent surface pour dévoiler, au grand jour, leurs horribles défauts et leur méchanceté primaire.
Ce site, dédié au vénérable saint François de Sales, a pour vocation de mettre en valeur l’un de ses ouvrages majeurs, « introduction à la vie dévote », grâce à une édition inédite de 1877 qui se veut rédigée dans un français contemporain sans, toutefois, tomber dans un modernisme excessif.
Pour que la vérité triomphe, vive Jésus !